 Voie protohistorique faite pour les marcheurs et animaux sous l’époque des Uceni, elle a été aménagée en route carrossable pour le commerce et le passage des légions par les Romains.
Voie protohistorique faite pour les marcheurs et animaux sous l’époque des Uceni, elle a été aménagée en route carrossable pour le commerce et le passage des légions par les Romains.
Avant la conquête romaine, cette région est habité par les Ucènes (Ucennii en latin qui est à l’origine du mot Oisans). Cette peuplade, implantait sans doute depuis le 8e siècle avant J.-C, occupait le bassin de la Romanche avec les vallées affluentes et contrôlait de part sa position la voie commerciale entre Lyon et Turin via Grenoble, Bourg d’Oisans, le col de Lautaret, Briançon et Montgenèvre. Entourés par d’autres peuples indépendants comme eux, les Médulles, les Tricores, les Ceutrons, les Allobroges, ils jouissaient d’une existence propre et d’une autonomie complète à l’abri de la grande enceinte des monts qui les protégeait. Un sol fertile, des rivières, d’immenses montagnes procuraient des avantages exceptionnels non seulement pour son bien être intérieur, mais encore pour les échanges et le commerce. L’exploitation de mines nombreuses, ajoutait à ces avantages une source féconde de richesses. Les habitants du pays ucénien avaient une civilisation avancée (hypothèse corroborée par la découverte en plusieurs points de la région (Ventelon ,Venosc, …), d’objets divers et précieux, signes de distinction chez les peuples de la Gaule). Ainsi que tous leurs voisins, les Uceni étaient constitués en peuplade guerrière, chargée principalement de la défense du sol contre les ennemis du dehors. Les guerriers étaient des hommes robustes habitués à une vie laborieuse, aguerris par l’exercice périlleux de la chasse aux bêtes féroces, et préparés aux dangers de la guerre.
Le temps vint où ils allaient déployer toutes ces qualités contre un ennemi dont ils connaissaient la puissance. Rome, déjà maitresse d’une partie du monde, méditait la conquête des Gaules, et le pays des Uceni, situé non loin de la frontière italienne, pouvait lui fournir à cet effet un passage fort utile permettant d’accéder directement aux limites de l’empire romain. C’était le chemin le plus court de l’Allobrogie. En 58 avant J.-C, César dirigea ses troupes par ce chemin jugé plus favorable que d’autres à ses desseins ultérieurs. Mais, dès qu’il s’y fut engagé, il trouva les Uceni sur son passage. Chaque trajet tenté à travers leur peuplade était pour les Romains une série de luttes sanglantes où le nombre finissait toujours par l’emporter, mais qui n’en compromettaient pas moins le succès de leurs expéditions. Afin d’obtenir par là une circulation libre pour des légions il fallut d’abord dompter ces ennemis dont la résistance était si redoutable. Une dernière bataille fut livrée sur le plateau de Mont-de-Lans dans laquelle les Uceni, malgré une résistance opiniâtre et de valeureux efforts furent définitivement soumis et vaincus. C’est sans doute pour célébrer cette victoire décisive, qu’a été dressé, près du lieu qui en fut témoin, l’arc triomphal encore existant sur le territoire de cette commune, et connue sous le nom de « Porte des Romains ». Un monument de genre, élevé en cet endroit, signifiait de la part des vainqueurs l’importance du pays conquis et le prix qu’avait dû leur coûter la victoire. Rien ne prouva mieux d’ailleurs la vaillance et le patriotisme des Uceni, par la défense de leur pays contre l’invasion romaine, que l’honneur de voir leur nom inscrit, au rapport de Pline, sur le trophée des Alpes érigé par Auguste, au nombre des quarante peuples guerriers que Rome dut vaincre avant d’assujettir la Gaule.
Devenus maîtres du pays ucénien, les Romains s’empressèrent de mettre au service de l’invasion le chemin dont la possession leur avait été à cœur parce qu’ils en avaient compris toute l’utilité stratégique. La voie protohistorique était faite pour des marcheurs et des animaux, bâtés ou non, mais les Romains avaient besoin d’une route carrossable pour le commerce et le passage des légions. Pour cela, ils ont appliqué leurs talents de constructeur à l’édification de la route en haute montagne, route que la Table de Peutinger et l’Anonyme de Ravenne indiquent comme un grande voie transalpine. C’est la plus courte pour relier Rome à Lyon. La voie romaine sera aménagée entre l’an 13 et l’an 6 avant J.-C, sur le tracé de l’ancienne voie protohistorique en empruntant les bords de la Romanche au prix d’aménagements importants par les ingénieurs romains : c’est probablement ces travaux sur une route essentielle pour Rome qui ont frappé les esprits jusqu’à donner le nom de « Romanche » au torrent qu’elle suit sur une bonne partie de son cours. Lorsqu’ils eurent ensuite assuré leur domination sur les Gaules, les Alpes n’ayant plus pour eux de barrière, leur empire s’étendait incontesté sur les deux versants de la chaine centrale. Les provinces du versant occidental formaient la Gaule transalpine, et celles du versant oriental, la Gaule cisalpine. Chacune d’elles avaient ses villes métropoles et ces villes privilégiées étaient reliées entre elles par des voies spéciales qui franchissaient les chaines. Au nombre de ces métropoles se trouvaient la cité de Turin, pour la Gaule cisalpine, et celle de Vienne pour la Gaule transalpine. On songea à rattacher l’une à l’autre ces deux cités importantes, et le lien le plus direct pour elles se trouva dans la voie, des Alpes Cottiennes ou Briançonnais venait traverser la contrée des Uceni ou l’Oisans, et passait à Grenoble pour aller aboutir à Vienne. Les Romains ; qui connaissaient cette voie, la choisirent et la mirent dans l’état de viabilité convenable, à travers la montagne. Classée Parmi les voies consulaires, celle-ci eut une largeur de 5 mètres, et fut rendues partout carrossable sur son parcours dans le pays ucénien ; 3 ou 4 localités, situées à des distances à peu près égales (Gavet, Boug d’Oisans, Mont de Lans, Villar-d’Arêne), furent constituées en stations pour les étapes militaires, pour le campement des légions, le relais des chars etc. Afin de compléter le système de leur stratégie sur la contrée, une nouvelle ligne fut établie par eux, qui, se détachant de la Voie vers le milieu de son trajet dans le pays ucénien, allait, par la montagne d’Auris de Brandes, d’OZ et par la vallée d’Olle, passer le Col de la Coche, pour rejoindre, au delà de la chaine, la voie romaine de la vallée supérieure de l’Isère. Cette ligne, en se bifurquant sur le plateau de Brandes fournissait une voie latérale au grand établissement fondé par les Romains sur cette montagne, pour l’exploitation des mines des Rousses, devenues aussi leur propriété, et pour la communication de cet établissement avec la voie principale. Aussi bien que celle-ci, ces deux voies secondaires existaient probablement avant les romains, qui ne firent que les transformer, en les agrandissant. A la différence des routes qui leur ont succédé, ces voies, dans leur parcours en Oisans, se tenaient généralement sur les hauteurs évitant les vallées, à cause des torrents qui les couvraient de leurs divagations. Dans leur marche, elles avaient même à parcourir des plateaux élevés, tels que ceux de Paris, de Rif-Tort , de Brandes etc. Ces plateaux, que leur hauteur moyenne de 1800 mètres et un rude climat rendraient impraticables aujourd’hui pour une voie publique, étaient sous les Romains et plusieurs siècles après, couverts de forêts ou de cultures et habités. Ainsi l’attestent, avec la tradition, des traces de terrains cultivés, des actes publics d’aliénation de parcelles, aux archives des communes, la découverte de bois enfouis et la présence de nombreuses ruines d’habitations. Là où la culture était possible, où végétaient des forêts et où l’homme pouvait résider, la climature des lieux ne mettait aucun obstacle à une circulation continue.
Cette circulation fut très active, tant que dura l’empire gallo romain et s’affaiblit après sa chute. Elle cessa tout à fait au XIV siècle. Un déboisement destructeur des bois qui ombrageaient ces plateaux détermina la ruine de la Voie par l’influence fatale qu’il exerça sur eux. A sa suite, la température s ‘y abaissa, le climat devint âpre et rigoureux le sol aride et les habitations se dépeuplèrent. Chassée de ces hauts lieux avec la population, la circulation publique descendit dans les vallées. La même cause eut, sur d’autres points de l’Oisans des effets non moins désastreux pour la voie. Le sol déjà désorganisé par les guerres fut de plus en certains endroits bouleversé par le déboisement. Privés de la garantie que la végétation et les bois leur avaient assuré contre les eaux, des terrains fortement inclinés croulaient dans les précipices avec la voie qu’ils supportaient. Tels ont été les changements survenus, de ces diverses manières, en quelques lieux où passait la Voie, qu’ils semblent y rendre aujourd’hui, son passage impossible. Des causes d’un autre genre contribuaient aussi un peu partout dans l’Oisans, au dépérissement de la Voie. Une fois délaissée, sa trace était en grande partie absorbée par les cultures qui l’avoisinaient ; dans les bois dans les champs, peu à peu elle disparaissait ignorée ; des chemins communaux s’en appropriaient des parties à leur convenance, sans se souvenir de leur antiquité vénérable. Du moins, un peu partout aussi, des sentiers gardaient sa place, et témoignaient de son existence passée, jusque dans les endroits les plus solitaires.
En complément : Les traces les plus anciennes d’habitat temporaire relevé en Oisans remontent au mésolithique (environ 7000 ans avant J.-C). Au début du second millénaire avant J.-C, une trace d’exploitation minière est découverte près de Vaujany. Les artéfacts en terre cuite, en bronze, en cuivre trouvés à Mont-de-Lans et Villard-Notre-Dame apportent les preuves d’une implantation permanente à partir du 8e siècle avant J.-C. Certains objets importés montrent l’existence d’un commerce entre l’Italie et la France.
Sources:
http://www.eric-tasset.com/
http://aimebocquet.com/index1.htm
http://jean.gallian.free.fr/bell2/histoire/histmat.html
Archives de catégorie : Oisans
Le Dauphiné
 Le Dauphiné, principauté indépendante au milieu du moyen âge puis province royale jusqu’à la révolution, tient son unité de l’histoire. Son territoire si vaste et divers – des Ecrins à la vallée du Rhône, des confins de la Bresse aux terres Provençales – ne favorisait pourtant pas une unité économique ou démographique, ni la formation d’une véritable identité culturelle. Cependant durant près de 800 ans, une construction politique forte a permis à cette région d’exister et de se développer. Aujourd’hui éclaté sur trois départements (Isère, Drôme, Hautes-Alpes), le Dauphiné reste une identité forte et bien ancré dans la mémoire des Dauphinois.
Le Dauphiné, principauté indépendante au milieu du moyen âge puis province royale jusqu’à la révolution, tient son unité de l’histoire. Son territoire si vaste et divers – des Ecrins à la vallée du Rhône, des confins de la Bresse aux terres Provençales – ne favorisait pourtant pas une unité économique ou démographique, ni la formation d’une véritable identité culturelle. Cependant durant près de 800 ans, une construction politique forte a permis à cette région d’exister et de se développer. Aujourd’hui éclaté sur trois départements (Isère, Drôme, Hautes-Alpes), le Dauphiné reste une identité forte et bien ancré dans la mémoire des Dauphinois.
Occupé jadis par des tribus Gauloises dont les Allobroges, ce vaste territoire fut conquit par les romains à partir de 125 av. J.-C. A la fin du 5e siècle, profitant de l’effondrement de l’Empire romain d’Occident, les Burgondes fondent un vaste royaume qui couvre pratiquement tout le Sud-Est. Intégré au royaume des Francs mérovingiens à la fin du 6e siècle, ce territoire prend le nom de royaume de Bourgogne. Au 9e siècle, l’éloignement des centres du pouvoir, l’aspiration des aristocrates à une plus grande autonomie, la révolution castrale (multiplication des châteaux « privés ») favorisent l’émergence d’une conscience régionale. C’est du sein de ces lignages aristocratiques que s’affirme au début du 11e siècle, la famille des Guigues (comtes d’Albon) qui portera un siècle plus tard le titre de Dauphin. Loin des plaines du bas pays ou la concurrence des autres familles est trop forte, c’est dans les zones de montagnes que les premiers Dauphins vont établir leur autorité. Il faut attendre 1285 et la troisième génération de princes pour voir apparaitre la première occurrence du mot Dauphiné. En 1349, Humbert II cède la principauté du Dauphiné à la couronne de France et confie son pouvoir au petit-fils du roi de France, le futur Charles V (d’où le nom de « Dauphin » donné à l’héritier de la couronne). Durant plus de deux siècles, le Dauphiné conserve encore une certaine autonomie (assemblée autorisée à négocier l’impôt royal, droit de battre une monnaie ayant cours par tout le royaume, …). Au milieu du 17e siècle, Louis XIV parle de province du Dauphiné et non plus de principauté. Vocabulaire chargé de sens qui signifie le passage de l’héritage féodale « principauté » à des parties bien délimitées du royaume soumises à l’autorité du roi. Le 18e siècle fut une période de prospérité et de croissance économique pour le Dauphiné, dont la bourgeoisie, qui en récolta les fruits, fut à la tête du mouvement de contestation qui aboutit à la révolution puis à l’éclatement du Dauphiné en trois départements (Isère, Drôme, Hautes-Alpes) en février 1790.
Pratiquement, deux siècles plus tard, en 1982, le Dauphiné se trouva de nouveau partagé entre les régions Rhône-Alpes (comprenant la Drôme et l’Isère) et Provence-Alpes-Côte d’Azur (incluant les Hautes-Alpes). Malgré tous ces découpages, le souvenir du Dauphiné perdure dans les mémoires, notamment à Grenoble qui fut durant plusieurs siècles le siège du parlement Dauphinois. Le drapeau du Dauphiné, dans sa version royale, est toujours fièrement affiché aux portes de Grenoble.
Pourquoi un Dauphin, symbole du Dauphiné ?
 L’emblème du Dauphin est arboré par quelques chevaliers au retour de la première croisade (1099) dont les comtes d’Albon. Le Dauphin représente un animal de salut et de triomphe. Certains comtes d’Albon vont s’approprier ce symbole d’abord comme prénom (Delphinus), puis comme nom patronyme et enfin comme un titre de dignité. Il prend définitivement ce dernier sens à la fin du 13e siècle, avec l’avènement d’Humbert 1er.
L’emblème du Dauphin est arboré par quelques chevaliers au retour de la première croisade (1099) dont les comtes d’Albon. Le Dauphin représente un animal de salut et de triomphe. Certains comtes d’Albon vont s’approprier ce symbole d’abord comme prénom (Delphinus), puis comme nom patronyme et enfin comme un titre de dignité. Il prend définitivement ce dernier sens à la fin du 13e siècle, avec l’avènement d’Humbert 1er.
Sources :
Nouvelle histoire du Dauphiné, édition Glénat
Histoire du Dauphiné, édition Yoran
Les glaciers rocheux
Un glacier rocheux est une masse de débris rocheux contenant de la glace en quantité suffisante pour que le « mélange » s’écoule sur la pente sous l’effet de la pesanteur. Les vitesses, bien plus lentes que celles des glaciers, sont de l’ordre de quelques décimètres à quelques mètres par an. Contrairement aux glaciers, les glaciers rocheux ne voient pas leur front reculer, ces derniers ne peuvent que progresser vers l’aval. Ils ressemblent à une coulée de lave d’apparence figée.
Le gel permanent du sol, pergélisol ou permafrost, est souvent à l’origine des glaciers rocheux, et, dans tous les cas, il permet leur maintien et leur fonctionnement. Les conditions favorables au pergélisol et aux glaciers rocheux se rencontrent généralement à partir de 2400-2500 m d’altitude en ubac, et 2800 m en adret, avec une fréquence plus marquée dans les parties sèches (Alpes internes) où les glaciers sont relégués à plus de 3000 m ( Briançonnais, Queyras, Vanoise, etc.)
Sous quelques mètres de débris rocheux, la glace apparaît, sous forme massive (avec des strates de plusieurs mètres d’épaisseur) ou sous forme interstitielle, enrobant les blocs, avec des proportions très variables (de 10 à plus de 60%). Les études montrent que cette glace s’est formée il y a plusieurs siècles, voire plusieurs milliers d’années. Le retrait des grands glaciers du « Dernier Maximum Glaciaire » (il y a environ 12 000 ans, quand les glaciers atteignaient Lyon) est généralement considéré comme la période d’initiation des glaciers rocheux, dont certains, les plus bas, ont pu depuis devenir inactifs, voire fossiles.
NEIGE ou neige !
La neige, un élément de plus en plus rare en station … Mais quelles différences entre neige naturelle, de culture voire artificielle ?
Neige de culture par universcience-lemonde
Formation de la neige naturelle
Dans les nuages, l’eau est sous forme liquide, même si les températures avoisinent les -10°C (alors qu’elle devrait être à l’état de glace dès 0°C environ). Ce phénomène très fréquent s’appelle la surfusion. Ainsi, l’eau reste liquide et ne se solidifie pas. Pour qu’il y ait congélation des gouttelettes, il doit y avoir présence de noyaux de nucléation (ou de condensation). Ce sont des particules de quelques micromètres (poussières industrielles, sels marins, minéraux divers…), qui vont rompre l’état d’équilibre entre l’air ambiant et l’eau en surfusion. Alors les petites gouttelettes vont se congeler autour des poussières pour former des germes de glace de forme hexagonale.
Par transferts d’énergie, on va voir les germes de glace se développer au profit des gouttelettes d’eau qui vont finalement disparaître. Cette croissance va être différente selon la température ambiante, et va donc former des cristaux de forme différente. Une fois que les cristaux seront suffisamment lourds, ils vont tomber. On trouve 3 types de croissances principales : Type aiguille entre -6°C et -10°C, type plaquette à -12°C et type étoile entre -13°C et -18°C.
Formation de la neige de culture
Au travers des canons à neige, on projette de l’eau sous pression dans l’air par un tout petit orifice, ce qui permet la formation de micro gouttelettes. Mais à cause du phénomène de surfusion, l’eau ne va pas geler, même si la température extérieure est négative. On va alors devoir former en parallèle les noyaux de condensation (ou de nucléation) qui vont permettre la cristallisation des gouttelettes. Pour se faire, on réalise un mélange d’eau et d’air sous pression, avec une infime quantité d’eau. Alors le peu d’eau va, avec la pression de l’air, s’atomiser aussi en de minuscules particules. Au contact de l’air froid, ces particules seront tellement petites qu’elle vont geler. On forme ainsi de toutes petites particules de glaces, qui serviront de noyaux de nucléation.
Ensuite, il suffit de se faire rencontrer à la sortie du canon ces deux jets pour former la neige de culture. La goutte d’eau transformée en glace va alors atteindre le sol, pour former le manteau neigeux. Les conditions idéales pour la formation de la neige sont -10°C et 20% d’humidité de l’air. Un mètre cube d’eau permet de produire environ 2 mètres cubes de neige pour un coût de 1,5 €.
Différence entre neige naturelle et de culture
La différence primordiale est la structure: La neige naturelle se forme à partir d’un germe de glace hexagonal. La neige de culture se forme à partir de gouttelettes d’eau de forme sphériques et ne pourra donc pas avoir de différences de croissance, elle va forcément donner des grains de neige sphériques. La neige de culture est ainsi plus stable, avec une meilleure cohésion. Elle est aussi plus dense, et résiste mieux au damage. Par contre, elle va plus vite former des plaques de glace, surtout si elle est humide. En effet de part sa géométrie, la seule évolution possible est la fonte, formant des plaques de verglas.
Dérives de la neige de culture
La neige de culture est 100% naturelle. Si le procédé de fabrication est artificiel, il retrace le mode de fabrication naturel de la neige constitué d’eau et d’air. Il faut donc bannir le terme de neige artificielle, d’ailleurs jamais employé dans le milieu de la neige de culture.
Cependant, il existe des dérives artificielles de la neige de culture. Celle qui fait beaucoup parler d’elle est le Snowmax de la société leader du marché York Neige. Elle consiste en fait à pulvériser avec l’eau des bactéries désactivées qui vont accélérer le processus de refroidissement de la neige. Il devient alors possible de former de la neige à des températures légèrement plus élevées (0°C), mais surtout on obtient une neige de meilleure qualité, plus sèche. Ce procédé très répandu à l’étranger est pour l’instant interdit en France.
Le Dauphiné, berceau du ski Français
 En usage depuis fort longtemps dans les pays scandinaves, le ski ne fera son apparition en France qu’a la fin du XIXe siècle sous l’impulsion de l’armée mais aussi de quelques précurseurs.
En usage depuis fort longtemps dans les pays scandinaves, le ski ne fera son apparition en France qu’a la fin du XIXe siècle sous l’impulsion de l’armée mais aussi de quelques précurseurs.
C’est dans les Hautes-Alpes, sur la montagne du Mt Guillaume au dessus d’Embrun, que sera réalisé en 1897, par le lieutenant Charles Widman, une des premières ascensions à ski des Alpes Françaises. Il démontra ainsi que le ski était un moyen plus rapide que les raquettes alors utilisées par les troupes de montagnes. Avec le capitaine Clerc du 159ièm RIA (Régiment d’Infanterie Alpine) de Briançon, ils vont contribuer a promouvoir l’utilisation du ski au sein de l’armée. C’est durant l’hivers 1901-1902 que l’on voit les premiers soldats du 159ièm RIA apprendre la nouvelle technique du ski. Bien que rapide, ce mode de déplacement est considéré comme dangereux car pour s’arrêter on utilise « l’arrêt Briançonnais » qui consiste a se laisser tomber brusquement. Le RIA fonde en 1903 la première école de ski mais c’est en 1906 que le ministère officialise l’Ecole Normale de Ski et confie sa mise en place au 159ièm RIA de Briançon qui devient « le régiment de la neige » au sein duquel, les capitanes Bernard et Rivas vont tenter d’améliorer la technique et apprendre aux hommes à skier et à fabriquer eux-mêmes leurs skis. Les planches « à la Briançonnaise » sont généralement fabriquées avec du frêne, font 2 mètres de long et sont utilisées avec un long bâton de la taille du skieur.
Parallèlement, le ski loisir nait sous l’impulsion de Henri Duhamel dans le massif de Belledonne en Isère. Il s’attribue des premiers essais à partir de 1878, mais c’est sans doute après 1890, qu’il commence à réaliser des parcours en ski. En 1895, il crée avec quelques amis le premier ski club de France. Ils s’entrainent sur les pentes de Chamrousse, organisent des sorties et contribuent ainsi à donner une image du ski comme « exercice agréable dans l’air vivifiant » !
Le premier concours international de ski est organisé en 1907, à Montgenèvre. Il regroupe les militaires mais aussi des skieurs venus de Norvège. Cette manifestation connaitra un grand succès auprès du public et va favoriser le développement tout azimut de ce nouveau sport. L’année suivante, le ski parvient a son premier apogée …
Atlas du Parc National des Ecrins
Pour tout connaître sur la faune et la flore du Parc National des Ecrins, un nouveau site @ est ouvert. On peut notamment suivre en temps réel cette magnifique biodiversité avec plus de 500000 observations pour 4077 espèces : Atlas PNE
Cordes, pitons et mousquetons
 Aujourd’hui, matériaux usuels et communs pour les alpinistes et grimpeurs, leur utilisation comme chaîne d’assurage a seulement un siècle !
Aujourd’hui, matériaux usuels et communs pour les alpinistes et grimpeurs, leur utilisation comme chaîne d’assurage a seulement un siècle !
La corde est sans doute le plus ancien moyen d’assurage utilisé. On trouve des descriptions de son utilisation dès le XVIe siècle où des paysans s’en servaient pour franchir cols et glaciers. Cependant, il faut attendre le milieu du XIXe siècle pour voir son utilisation se généraliser mais sans faire l’unanimité. En effet, la corde d’alors est faite en chanvre, putrescible, sans élasticité, de faible résistance (500kg) et simplement passé autour de la taille. Si elle peut sauver des vies en provoquant parfois de graves traumatismes, elle peut aussi engendrer des tragédies dont la plus tristement connue est celle du Cervin qui précipite dans le vide quatre alpinistes après rupture de celle-ci! Elle va cependant devenir indispensable dès le début du XXe siècle avec l’ascension de voies d’escalade plus difficiles, puis utilisée systématiquement à partir de 1910 avec l’invention conjointe des pitons et mousquetons. Le matériaux évolue en 1947 grâce à la société Française Joanny qui remplace le chanvre par du nylon ce qui permet de rendre la corde dynamique et plus résistante. Elle dispose de nos jours d’une élasticité permettant d’absorber les chutes et sa charge de rupture dépasse les 2500kg. Il faut aussi noter l’arrivée en 1970 du harnais ou baudrier (développé par un Anglais) qui permet de ne plus s’encorder à la taille.
L’utilisation des pitons remonte sans doute à la fin du XIXe siècle, époque à laquelle il sert essentiellement de point d’ancrage pour les rappels. Son évolution et développement est étroitement liée à celle du mousqueton, accessoire fondamental qui permet de faire le lien entre le piton et la corde. Jusqu’au début du XXe siècle, les grimpeurs devaient se décorder pour passer la corde dans l’œil du piton ! C’est vers 1910, dans les Alpes orientales qu’apparait cette chaine d’assurage (piton, mousqueton, corde) dont le principe est toujours appliqué aujourd’hui. Les premiers modèles de mousqueton utilisés par les pompiers munichois, sont repris et améliorés par les alpinistes Autrichiens et Allemands, mais ils sont lourds (130g) et présentent une faible résistance (450kg). Une avancée essentielle survient en 1939 avec le Français Pierre Alain qui conçoit le mousqueton moderne et réduit le poids de moitié (63g) tout en augmentant la résistance (750kg). Commercialisé après la seconde guerre mondiale, les modèles actuels en sont toujours dérivés avec des performances fortement améliorées. On trouve des mousquetons avec un poids de moins de 30g pour une résistance de plus de 2300kg. On notera aussi l’arrivée dans les années 1980 des goujons, tiges forées dans le rocher, qui présentent une résistance supérieure à celle des pitons (2500kg).
En France, cette chaîne d’assurage est présentée en 1932 dans la revue La Montagne mais contrairement aux Alpes orientales, son usage bien que connu reste d’une utilisation modérée jusque dans les années 1950.
Et en Oisans ! Le premier piton planté semble attribué à la cordée Autrichienne Purtscheller-Zygmondy en 1885 lors de la première traversée des arêtes de la Meije. Ce piton leur sert a accrocher la corde pour descendre à la force des bras à la brèche sous le Grand Pic. Il faut attendre les années 1930 pour voir ce système de progression et d’assurage utilisé en tant que tel, peut être par la cordée Boell-Le Ray lors de l’ascension de la face Sud de la Dibona en 1932. Source: Dictionnaire thématique des Alpes (Glénat) – Photos: Samivel
Source: Dictionnaire thématique des Alpes (Glénat) – Photos: Samivel
Le carré magique du Valbonnais
Situé dans la partie Ouest de l’Oisans, le village de Valbonnais (Isère) a son carré magique !
Connu depuis le XVe siècle, le carré SATOR du Valbonnais est taillé dans un bloc de gneiss. Situé à l’origine sur une maison du bourg, il est aujourd’hui placé au centre du village dans la Grande Rue à Valbonnais.
Il s’agit d’une inscription que l’on trouve en divers lieux et qui a fait couler beaucoup d’encre. Ce sont cinq mots latins dont la signification reste obscure. Il pourrait s’agir d’un signe de reconnaissance utilisé par les chrétiens durant les persécutions mais l’origine remonte sans doute aux premiers siècles de notre ère et il a pu avoir le même sens pendant le christianisme primitif sous les persécutions romaines.
Le carré SATOR est un palindrome , il se lit dans les deux sens de gauche à droite, de bas en haut et vice versa d’où l’appellation de carré magique. Il est composé des cinq mots :
– Sator : laboureur, planteur, semeur ; ou créateur, père, auteur
– Arepo : signification inconnue
– Tenet : il tient ; ou il tient en son pouvoir, voire maintient
– Opera : œuvre, travail, soin
– Rotas : roues ou rotation, orbite, révolution
Le mot Arepo est un hapax: il n’apparaît nulle part ailleurs dans la littérature latine. Il est probable qu’il s’agisse d’un nom propre. Moult interprétations sont possibles et comme c’est un carré magique, il y a autant d’interprétations que de sens de lecture.
On notera aussi que les lettres de ce carré constituent une anagramme, qui, disposé en croix, donne deux fois : Pater noster, auquel on ajoute deux fois les lettres « A » et « O ». Ces dernières pouvant représenter « l’Alpha et l’Oméga ». Par ailleurs, le mot TENET situé au centre forme une image de croix, ce que suggère aussi la forme du T.
Glacier Blanc, encore un bilan négatif
 Le dernier relevé a été réalisé le 30 septembre et la conclusion est sans appel ! Le bilan 2016 est un peu plus mauvais que la moyenne (-78 cm d’eau (environ – 85cm) pour -60cm à la moyenne). Depuis 2002, il a perdu en moyenne plus de 11 mètres d’épaisseur de glace avec des variations importantes fonction de l’altitude et le recul de la langue glaciaire approche les 800 mètres !
Le dernier relevé a été réalisé le 30 septembre et la conclusion est sans appel ! Le bilan 2016 est un peu plus mauvais que la moyenne (-78 cm d’eau (environ – 85cm) pour -60cm à la moyenne). Depuis 2002, il a perdu en moyenne plus de 11 mètres d’épaisseur de glace avec des variations importantes fonction de l’altitude et le recul de la langue glaciaire approche les 800 mètres !
Tous les glaciers des Ecrins subissent le même sort et leur disparition semble inéluctable. Sur les 213 glaciers inventoriés dans les Ecrins en 1971, il en restait 153 en 2009: 60 glaciers ont disparu en moins de 40 ans. Pour autant, le nombre d’entités glaciaires a augmenté car la plupart des survivants se sont morcelés en 2, 3 … et jusqu’à 9 morceaux ! Entre 1971 et 2009, la surface englacée du massif des Ecrins est passée de 100,4 km² à 68,7 km². Pendant cette période, en raison de sa situation méridionale, le retrait glaciaire dans les Ecrins a été trois fois supérieur à celui du massif du Mont-Blanc. Si l’on compte une perte moyenne d’1 km²/an, on peut considérer qu’elle est aujourd’hui de l’ordre de 62 km². Partout, la vitesse du retrait s’est accélérée ces dernières décennies sous l’effet du changement climatique. On estime qu’une cinquantaine de glaciers supplémentaires, les plus petits, sont voués à disparaître dans les dix à quinze ans qui viennent dans les Écrins.
Source: PNE
Sentiers des Ecrins
 Le massif des Ecrins ne peut se parcourir qu’a pied. Sans doute un privilège qui le préserve de la sur-fréquentation ! C’est grâce aux sentiers qui le sillonnent que l’on accède au cœur de l’Oisans. Mais ces chemins qui nous permettent aujourd’hui de pratiquer la randonnée pédestre ont tous une longue histoire …
Le massif des Ecrins ne peut se parcourir qu’a pied. Sans doute un privilège qui le préserve de la sur-fréquentation ! C’est grâce aux sentiers qui le sillonnent que l’on accède au cœur de l’Oisans. Mais ces chemins qui nous permettent aujourd’hui de pratiquer la randonnée pédestre ont tous une longue histoire …
Au début, il n’y avait rien ! Puis peu à peu sont apparus des traces, sentes, drailles et enfin des sentiers se faufilant au travers des montagnes, utilisant les passages les plus aisés et permettant la circulation des hommes. Difficile de dire à quand remonte les premiers chemins, mais ils existent depuis fort longtemps ; Il y a quelque 9000 ans, des hommes ont campé au fond du vallon du Fournel. Voies de communication et d’échange entre villages et vallées depuis l’époque romaine, ils sont devenus sentiers de fuite (chemins des protestants), puis militaires, pastoral, forestiers, aménageurs, facteurs, … et enfin randonneurs depuis le milieu du XXe. C’est à partir de cette époque que les sentiers prennent une nouvelle fonction avec l’arrivée des “excursionnistes” puis des alpinistes. Grande nouveauté, on marche “pour le plaisir”… Après les aristocrates à la conquête des Alpes (Whymper, Coolidge et autre miss Breevort), les congés payés démocratisent la pratique. En 1936, les amoureux de la marche à pied et de la nature prennent le chemin des montagnes.
Les premiers sentiers de grande randonnée (GR) ont été tracés en France en 1947. Pour le massif des Ecrins, c’est au printemps 1964 que le GR54 est crée. Il fait partie de la trilogie des sentiers GR des Alpes française avec le Mt Blanc et la Vanoise mais c’est sans doute le plus sauvage. Il contourne l’Oisans à travers l’Isère et les Hautes-Alpes. 180km à parcourir, 14 cols et plus de 12800 mètres de dénivelé. Les Ecrins comptent aujourd’hui près de 700 km de sentiers.
Le Tour des Écrins, un itinéraire de légende !
C’est pendant l’hiver 1962-63, que Roger Canac pense à un sentier faisant le tour des Ecrins. Un tracé sur une carte va devenir progressivement un itinéraire qui s’organise avec quelques copains (Jean-Alix Martinez, Claude Couttaze, …) et connaissances contactés dans les différentes vallée. Il s’agit de s’assurer que les passages sont utilisables et que les randonneurs trouveront un lieu pour dormir à chaque étape. Le comité national des sentiers de grande randonnée a dit son intérêt sur le principe, il fournit le matériel de balisage… mais pas d’argent. Quand tout sera au point, il assurera la promotion de l’itinéraire et éditera le topo-guide. Les maisons des jeunes de Bourg d’Oisans, de la Mure et de Lyon apportent leur contribution pour la prospection puis le balisage. La réalisation progresse jusqu’à devenir une “oeuvre collective”, informelle au départ puis appuyée par les organismes officiels : services des eaux et forêts, collectivités, Club alpin français… Au printemps 1964, l’itinéraire est agréé officiellement “GR54”. À cette époque, certains cols, comme celui de l’Aup Martin n’avaient pas été pratiqués depuis plusieurs décennies. Les premiers randonneurs ont le sentiment d’être de véritables pionniers alors qu’ils empruntent en réalité des cheminements très anciens. On parlait déjà de créer un parc national. Quand il voit le jour, 10 ans plus tard, il bénéficie déjà d’une ossature de sentiers pour la découverte des vallées et des sommets prestigieux du massif… En 10 à 12 jours, le tour des Écrins passe par Bourg d’Oisans, La Grave, Le Monêtier-les-Bains, Vallouise, La Chapelle-en-Valgaudemar, Le Désert-en-Valjouffrey et Valsenestre. Désormais, l’entretien du GR 54 est assuré par le Parc, l’ONF, les communes et les Communautés de communes.
Sentier du ministre, une boutade !
Dans le Valgaudemar, le sentier du ministre chemine à flanc de montagne en direction des refuges de Vallonpierre et Chabournéou. Ce n’est pourtant pas une illustre personnalité qui a emprunté ce chemin muletier. Simplement, aux yeux des habitants, les ânes étaient au moins aussi utiles qu’un ministre. D’où l’appellation locale qui est restée dans les mémoires… et sur les cartes.
Source : Parc National des Ecrins
Le lac St Laurent
 Le lac Saint Laurent recouvrait toute la plaine de Bourg d’Oisans. Aujourd’hui disparu, il a été à l’origine du « déluge de Grenoble ».
Le lac Saint Laurent recouvrait toute la plaine de Bourg d’Oisans. Aujourd’hui disparu, il a été à l’origine du « déluge de Grenoble ».
On trouve des récits datant de 1058 qui mentionnent l’existence d’un lac dans la plaine de Bourg d’Oisans. Bourg d’Oisans s’appelait alors Saint Laurent du Lac. Il est difficile d’en estimer le volume et la profondeur mais on sait que ce dernier se vidangeait déjà périodiquement fonction des crues de la Romanche. C’est au XIIe siècle que la physionomie du lieu s’est fortement modifiée suite à un monstrueux éboulement !
Au mois d’août 1191, après un terrible orage, les torrents de l’Infernet et de la Vaudaine provoquent un éboulement très important dans le verrou rocheux à l’amont du village de Livet. Cet amoncellement de pierres, de boue et d’arbres empêche l’écoulement naturel de la rivière la Romanche. Petit à petit les eaux montent forçant les habitants de Saint Laurent du Lac (Bourg d’Oisans) à évacuer la plaine, pour s’installer vers les hauteurs.
 A son apogée, le lac s’étendait sur plus de 18 kilomètres de long, noyant sous plus de 10 mètres d’eau, la plaine de Bourg d’Oisans. Selon certains documents, la profondeur allait jusque 20 mètres !
A son apogée, le lac s’étendait sur plus de 18 kilomètres de long, noyant sous plus de 10 mètres d’eau, la plaine de Bourg d’Oisans. Selon certains documents, la profondeur allait jusque 20 mètres !
28 ans plus tard, le 14 septembre 1219, le barrage naturel céda sous le poids des eaux ; une énorme masse d’eau s’engouffra dans la vallée, la parcourut avec la violence d’un ouragan, brisant et emportant tout dans son cours furieux, arbres, terres, villages entiers. Cette rupture soudaine provoqua une inondation jusqu’à Grenoble faisant plus de 5000 morts.
Par la suite, bien que réduit, le lac Saint-Laurent exista encore pendant plus de trois siècles, renaissant parfois, comme le 4 août 1465 après un effroyable orage d’été. En 1540, réduit à une « flaque », il acheva de disparaître…
Les colères de la Romanche ne seront quant à elles, définitivement domptées qu’en 1935 avec la construction du Barrage du Chambon.
Légende de St Véran
La légende de Saint Véran raconte que, l’évêque de Cavaillon, blessa un dragon qui ravageait la région et le chassa en lui ordonnant d’aller mourir dans les Alpes …
https://youtu.be/N-l7SMLSaRQ
Les via ferrata
 La première via ferrata date de 1843. Installée sur la voie normale du
La première via ferrata date de 1843. Installée sur la voie normale du Hoher Dachtein (Autriche), elle permettait un accès aisé sur ce sommet de 2995m. S’inspirant des techniques Autrichienne, l’armée Italienne développe au début du XXe siècle ce concept en équipant certains passages escarpés des Dolomites avec des câbles et des échelons pour permettre aux troupes alpines de se déplacer rapidement d’une vallée à l’autre avec du matériel lourd voire d’accéder sur les points hauts pour positionner des pièces d’artillerie.
Hoher Dachtein (Autriche), elle permettait un accès aisé sur ce sommet de 2995m. S’inspirant des techniques Autrichienne, l’armée Italienne développe au début du XXe siècle ce concept en équipant certains passages escarpés des Dolomites avec des câbles et des échelons pour permettre aux troupes alpines de se déplacer rapidement d’une vallée à l’autre avec du matériel lourd voire d’accéder sur les points hauts pour positionner des pièces d’artillerie.
Les premiers itinéraires s’adressant au grand public sont créés à partir des années 1980 et en France, la première via ferrata est construite dans les Hautes-Alpes à Freissinières en 1988. Le succès est immédiat et d’autres itinéraires sont rapidement tracés à l’aiguille du Lauzet et aux Vigneaux (05). En 1992, on dénombrait 6 via ferrata en France, 70 en 2000 et plus de 200 en 2016.
Equipées à grand renforts d’équipements métalliques : barreaux, câbles, échelles, rampes, marches, etc, les via ferrata d’aujourd’hui permettent de parcourir les parois les plus verticales voire même de franchir des ravins, des surplombs et offrent ainsi un accès grandement facilité aux néophytes désireux de découvrir le monde vertical. C’est même devenu une activité à part entière avec ces codes, équipements, topos, … et cotations qui vont de F (Facile) à ED (Extrêmement Difficile). Cependant aucune comparaison n’est à faire avec l’escalade et l’alpinisme ! Quelqu’un de sportif et qui n’a pas l’appréhension du vide peu aisément se lancer dans des via ferrata de niveau ED.
Photos : Via ferrata des Vigneaux au tout début des années 90 avec un équipement rudimentaire (ni casques, ni longes, …) totalement proscrit aujourd’hui !
Gardiner et les Pilkington, pionniers de l’alpinisme sans guide
 La première ascension sans guide de la Meije revient à Gardiner accompagné des frères Pilkington qui réussiront cet exploit en 1879, soit deux ans après la première ascension. A la fin des années 1870, les montagnes de l’Oisans sont fréquentées par un petit nombre d’initiés, notamment anglais. Tout ce petit monde se connait bien et chaque nouveau venu fait l’objet d’une enquête en règle : qui il est, quels sont ses projets et ses ambitions pour les années futures. Ce microcosme est aussi entretenu par la rareté des hébergements qui sont des plus sommaires : Gauthier ou Giraud à Vallouise, Juge à la Grave. En 1878, deux protagonistes qui ont des ambitions bien distinctes vont partager durant une semaine l’ascension de différents sommets du Pelvoux. Il s’agit de W.A.B Coolidge, de ses guides et de Frederick Gardiner. Le premier a entrepris l’exploration méthodique des Alpes et collectionne les premières. Le second est davantage attiré par l’aventure et l’exploit sportif. Gardiner connait moins bien l’Oisans que Coolidge mais a beaucoup fréquenté les alpes Suisses. Il a été le premier à fouler l’Elbrouz, point culminant du Caucase, avec Horace Walker en 1874. L’aventure est pour lui un affrontement direct avec la montagne qui ne tolère aucun intermédiaire. Depuis quelques années déjà des cordées se lancent dans des ascensions difficiles sans l’aide d’un guide. Deux amis, Charles et Lawrence Pilkington et lui-même ont été impressionnés par la première « sans guide » du Cervin, en 1876, par trois anglais. C’est bien cela l’aventure, pensent-ils, la liberté d’assumer l’entière responsabilité de la course. L’important est que la cordée soit homogène. Gardiner, comme les Pilkington, a longtemps grimpé avec des guides. Chacun d’entre eux est capable de conduire la cordée et a une confiance égale dans les deux autres. cette même année 1878, on retrouve les trois compères, sans guide donc, aux Ecrins, à la pointe des Arcas, au pic Joselme. « Sans guide » ne veut pas toujours dire sans porteur. Leurs détracteurs ne manqueront pas de souligner cette ambiguïté. En revanche, l’engagement des grimpeurs est plus intense. Gardiner et les Pilkington se donnent les moyens de bivouaquer, conçoivent une espèce de sac de couchage triplace et divers modèle de piolets.
La première ascension sans guide de la Meije revient à Gardiner accompagné des frères Pilkington qui réussiront cet exploit en 1879, soit deux ans après la première ascension. A la fin des années 1870, les montagnes de l’Oisans sont fréquentées par un petit nombre d’initiés, notamment anglais. Tout ce petit monde se connait bien et chaque nouveau venu fait l’objet d’une enquête en règle : qui il est, quels sont ses projets et ses ambitions pour les années futures. Ce microcosme est aussi entretenu par la rareté des hébergements qui sont des plus sommaires : Gauthier ou Giraud à Vallouise, Juge à la Grave. En 1878, deux protagonistes qui ont des ambitions bien distinctes vont partager durant une semaine l’ascension de différents sommets du Pelvoux. Il s’agit de W.A.B Coolidge, de ses guides et de Frederick Gardiner. Le premier a entrepris l’exploration méthodique des Alpes et collectionne les premières. Le second est davantage attiré par l’aventure et l’exploit sportif. Gardiner connait moins bien l’Oisans que Coolidge mais a beaucoup fréquenté les alpes Suisses. Il a été le premier à fouler l’Elbrouz, point culminant du Caucase, avec Horace Walker en 1874. L’aventure est pour lui un affrontement direct avec la montagne qui ne tolère aucun intermédiaire. Depuis quelques années déjà des cordées se lancent dans des ascensions difficiles sans l’aide d’un guide. Deux amis, Charles et Lawrence Pilkington et lui-même ont été impressionnés par la première « sans guide » du Cervin, en 1876, par trois anglais. C’est bien cela l’aventure, pensent-ils, la liberté d’assumer l’entière responsabilité de la course. L’important est que la cordée soit homogène. Gardiner, comme les Pilkington, a longtemps grimpé avec des guides. Chacun d’entre eux est capable de conduire la cordée et a une confiance égale dans les deux autres. cette même année 1878, on retrouve les trois compères, sans guide donc, aux Ecrins, à la pointe des Arcas, au pic Joselme. « Sans guide » ne veut pas toujours dire sans porteur. Leurs détracteurs ne manqueront pas de souligner cette ambiguïté. En revanche, l’engagement des grimpeurs est plus intense. Gardiner et les Pilkington se donnent les moyens de bivouaquer, conçoivent une espèce de sac de couchage triplace et divers modèle de piolets.
L’année suivante, Gardiner revient dans les alpes du Dauphiné avec ses amis et une idée en tête. Les deux raisons pour lesquelles ils choisissent ces montagnes d’Oisans valent d’être citées: « parce qu’elles comprennent encore des cimes vierges ; parce que, n’ayant pas de guide, cette manière d’agir devait être moins perceptible d’éveiller l’attention en ce pays que dans d’autres régions des alpes plus à la mode. » Et parmi ces régions « à la mode » il y a Zermat et le Cervin dont la première ascension, en juillet 1865, se termina par la mort de quatre grimpeurs. L’alpinisme connu alors pendant plusieurs années une sorte de « paralysie » selon le mot de Coolidge. La cordée accidentée avait pourtant ce qu’il fallait de guides et d’expérience, mais un pas avait été franchi. L’aimable délassement de gentlemen fortunés pouvait viré au drame. Pour de longues années, l’opprobre est jeté sur les jeunes inconscients qui se lancent à la conquête des montagnes au risque de priver la couronne d’Angleterre de ses plus brillants sujets. Coolidge décrit les premiers alpinistes qui osèrent, après l’accident, reprendre le chemin des cimes : « … opérant autant que possible loin des regards curieux, ceux-ci allaient et venaient désormais comme des coupables, objets de réprobation mal déguisée de la part de la foule des touristes ordinaires. »
En Oisans donc, on est tranquille. Pour mener à bien leur projet, en plus de l’expérience et la discrétion, il leur faut assez de courage pour briser une tradition, un tabou. C’est inimaginable ce qu’ils vont tenter, la Meije sans guide, une sorte d’Everest sans oxygène pour oser une comparaison moderne. Et s’ils n’ont pas relaté leur ascension, « un défi à la raison », on sait que, parfaitement préparée, elle s’est déroulée sans incident. Les trois hommes trouvent au sommet quelques reliques laissées par les précédents ascensionnistes, en prélèvent des échantillons qui permettront d’authentifier leur exploit et déposent à leur tour un peu de pacotille dans cette boite au trésor. Il est coutume à cette époque de déposer dans une boite de fer blanc divers objets, morceaux de tissus, lettres signées, …C’est le moyen le plus sûr d’attester d’une ascension, aussi bien pour celui qui à déposé l’objet que pour celui qui va le trouver. L’année précédente alors qu’ils avaient employé deux porteurs lors de plusieurs ascensions dans le Valgaudemar, une presse pointilleuse avait mis en doute qu’ils aient grimpé pour de bon sans guide. Cette fois les indices récoltés au sommet de la Meije suffiront et Coolidge, croisé quelques jours plus tôt à la Bérarde, ne tarira pas d’éloges à propos de « cette course, la plus audacieuse et la mieux réussie de toutes celles qu’ont faites jusqu’à présent les ascensionnistes les pus hardis, et qui mérite sans contestation la première place dans les annales des alpes ».
Au cours des années suivantes, Gardiner et les Pilkington continueront d’aligner les premières sans guide, toujours avec le même souci de rigueur et de préparation et en conservant l’esprit d’aventure et d’engagement qui, selon eux, était le propre de l’alpinisme. Rien ne les opposaient aux guides, auxquels ils avaient également recours, si ce n’est la volonté d’être acteurs et responsables de leur expédition, pour qu’elle ait, à leurs yeux, une vraie valeur humaine. Revenant sur le sujet de l’escalade sans guide dans son grand ouvrage « Les alpes dans la nature et dans l’histoire (1913)», Coolidge en fait un des traits de l’alpinisme moderne, en rupture avec celui des pionniers, au même titre que la préférence donnée au rocher plutôt qu’aux courses sur glacier.
Pour être exhaustif, il faut aussi mentionner d’autres précurseurs tels que Charles Hudson qui fit la première sans guide du Mont Blanc en 1855, Albert Frederick Mummery, Les frères Zygmondy, Eugen Guido Lammer et sans doute d’autres …
Source: Profils Briançonnais de R. Siestrunck
Refuge de la Pilatte
 Situé à 2580m, au cœur du massif des Ecrins, le refuge de la Pilatte est construit sur un promontoire morainique dominant le glacier de la Pilatte. Or depuis quelques années, le socle granitique qui porte le refuge présente des failles qui sont auscultées depuis 2011. Ce phénomène s’explique par le recul du glacier qui en se retirant provoque une décompression des versants libérés. Depuis 1990, le glacier de la Pilatte a perdu près de 50 mètres d’épaisseur. Si cette menace se confirme, le refuge pourrait être reconstruit plus bas dans la vallée.
Situé à 2580m, au cœur du massif des Ecrins, le refuge de la Pilatte est construit sur un promontoire morainique dominant le glacier de la Pilatte. Or depuis quelques années, le socle granitique qui porte le refuge présente des failles qui sont auscultées depuis 2011. Ce phénomène s’explique par le recul du glacier qui en se retirant provoque une décompression des versants libérés. Depuis 1990, le glacier de la Pilatte a perdu près de 50 mètres d’épaisseur. Si cette menace se confirme, le refuge pourrait être reconstruit plus bas dans la vallée.
Source : Destabilisation du refuge de la pilatte
La Vallouise et les Vaudois

 L’histoire de la Vallouise et des Vaudois est fortement liée. Affluente de la Durance, la vallée de la Vallouise s’enfonce profondément dans le massif des Ecrins et donne accès à un des hauts lieux de l’alpinisme : Ailefoide. C’est une des portes d’entrée du massif des Ecrins. Longue de 25 km, elle s’étage entre 1000m et 1900m. Elle est dominée par le Pelvoux et vient mourir au pré de Madame Carles, sous les Ecrins. Mais sous ce doux nom se cache une histoire mouvementée !
L’histoire de la Vallouise et des Vaudois est fortement liée. Affluente de la Durance, la vallée de la Vallouise s’enfonce profondément dans le massif des Ecrins et donne accès à un des hauts lieux de l’alpinisme : Ailefoide. C’est une des portes d’entrée du massif des Ecrins. Longue de 25 km, elle s’étage entre 1000m et 1900m. Elle est dominée par le Pelvoux et vient mourir au pré de Madame Carles, sous les Ecrins. Mais sous ce doux nom se cache une histoire mouvementée !
Au commencement était « Vallis Gerontonica », la vallée du Gyr, nom attesté dès 739, tout droit tiré de sa position géographique. Puis vint l’intermède tragique des persécutions contre les Vaudois. Alors « Vallis Gerontonica » devint au XIIIe siècle « Vallis Puta » (Vallée mauvaise), refuge des populations jugées hérétiques . En 1486, elle prit pour nom de « Vallis Loyssia » en l’honneur du roi Louis XI, qui demanda que prennent fin les poursuites contre les Vaudois. « Vallis Loysia » s’écrivit successivement « Valloyse », puis « Val Loyse », enfin « Vallouise », nom qu’elle abandonna quelques temps sous la période révolutionnaire à la fin du XVIIIe-début du XIXe siècle pour « Val Libre ».
Mais qui sont ces Vaudois, traqués et persécutés durant près de six siècles ?
Au XIIe siècle nait une confrérie religieuse, issue de la doctrine de Pierre Valdès, riche commerçant Lyonnais parti prêcher la parole du Christ sans être ordonné. Avec ses disciples, il sera excommunié en 1184. Les Vaudois littéralement « pauvres de Lyon » militent pour le dépouillement, la simplicité, l’aide aux pauvres et réfutent une église trop fastueuse.
Après 1292, à la fin de la répression contre les Cathares, l’église va se retourner contre ce nouveau mouvement de contestations. Ils seront alors persécutés et se réfugieront dans les vallées dauphinoises (les Escartons), dans le Lubéron, le Bugey et dans toutes les Alpes, en particulier sur leur versant Est. Les Vaudois sont jugés hérétiques, emprisonnés, leurs bien confisqués. les persécutions s’intensifient sous l’inquisition, menée par les archevêques d’Embrun et les seigneurs locaux, dont le Dauphin Humbert II. Les Vaudois quittent les grandes vallées et trouvent refuge dans les vallées perchées du Briançonnais : Freissinères, Vallouise, Fournel seront pour un temps leurs terres d’asile.
En 1393, l’inquisiteur « diabolique », François Borrely, fera brûler vif 230 Vaudois, dont 150 Vallouisiens, sur la place de la tour brune à Embrun. Ceux survivant au massacre iront se cacher encore plus profondément dans les montagnes. En 1478, un semblant de sursis leur est accordé par Louis XI qui les défend contre les exactions de Jean Baile (archevêque d’Embrun). Mais après la mort du roi, la chasse reprend de plus belle.
De nombreux noms de lieux rappellent ces tristes épisodes, véritables massacres de familles entières : la Grotte des Vaudois et le Cimetière des Vaudois dans la vallée de Freissinières ; La Serre des Hommes Morts ou Baume Chapelue à Ailefroide. On raconte qu’à cet endroit, des dizaines de Vaudois furent contraints de se jeter dans le vide et leurs chapeaux restèrent accrochés sur la falaise.
Une embellie arrivera au XVIe siècle. En 1501, les Vaudois seront absous par le Pape Pie III et Louis XII ordonnera la restitution de leurs terres. Malheureusement, François 1er n’aura pas la même tolérance que son prédécesseur. En 1545, avec son aval, tout une communauté est massacrée dans le Luberon. Plus de 3000 personnes sont torturées et tuées, plus d’un millier d’hommes envoyés aux galères. En 1532, Ils seront « obligés » d’adhérer à l’église protestante mais cela ne mettra pas fin aux persécutions. Il faudra attendre le 17 février 1848 pour que les Vaudois puissent enfin avoir des droits civiques et la liberté religieuse.
Histoire des Ecrins
Ce point culminant du massif ne s’est pas toujours appelé ainsi. Son nom a divagué sérieusement, sans doute parce qu’il est situé au centre du massif et peu visible depuis les vallées. Au XVIIe siècle, c’était la Montagne des Glacières ou des Verrières ou de l’Aile-Froide. Plus tard, Pic ou Pointe des Arsines ou d’Oursine. La carte de Bourcet (1758) l’appelle Pointe des Verges. Sur le versant de Saint-Christophe, ce fut “La Tête des Trois Bœufs”…
C’est la carte d’état-major (1853) qui lui a donné un nom définitif. Mais alors pourquoi Ecrins? Le plus simple évidemment est de tirer son origine du mot “Ecrin” signifiant, dans l’Embrunais en particulier, coffre et par extension “Vallon fermé” la pointe ou barre des Ecrins étant alors la pointe qui domine le vallon fermé du Glacier Blanc. A rapprocher du Val d’Escreins près du Col de Vars dominé par la Font-Sancte. Mais cette étymologie est trop simpliste, on n’a jamais donné au vallon du Glacier Blanc un tel nom. La vérité est plus simple: le nom d’un sommet est souvent le nom de ce qu’il y a de plus caractéristique à ses pieds.
En fait, l’histoire est celle-ci. Lorsque les officiers cartographes vinrent établir la fameuse carte d’état-major qui fixa les noms, ils demandèrent aux gens de Vallouise le nom de cette montagne et on leur dit c’est la pointe d’Escrins, c’est -à-dire des coffres. En effet le XIXème siècle fut une période d’intenses recherches minières. Des coffres de bois ayant été placés en plusieurs endroits, le long des rochers au dessus de la rive gauche du Glacier Noir, on y faisait couler l’eau des ruisseaux et on la filtrait pour tenter de recueillir des traces de métal, de l’or, cet or plus ou moins mythique qui enivrait les montagnards de l’époque. Ainsi naquirent les Ecrins.
Source : Livre « Noms de lieux, quelle histoire ! » de Pierre Barnola et Danièle Vuarchex
Le chamois, animal emblématique des montagnes !

 Il allie la grâce à l’aisance dans ses déplacements que ce soit dans les éboulis, les pentes raides, les passages rocheux ou sur la neige dure. Son allure fragile n’est qu’apparente. Robuste et fort, il a un cœur puissant que tous les alpinistes lui envient et qui lui permet d’accomplir des efforts étonnants comme de gravir 1000 m de dénivelé en 15 minutes !
Il allie la grâce à l’aisance dans ses déplacements que ce soit dans les éboulis, les pentes raides, les passages rocheux ou sur la neige dure. Son allure fragile n’est qu’apparente. Robuste et fort, il a un cœur puissant que tous les alpinistes lui envient et qui lui permet d’accomplir des efforts étonnants comme de gravir 1000 m de dénivelé en 15 minutes !
La période de reproduction a lieu fin novembre, aux premières neiges. Elles sont l’occasion de belles poursuites et de sévères batailles entre mâles. La femelle met bas en mai un chevreau qui ne quitte pas sa mère d’un sabot pendant toute une année, avant de prendre son indépendance. Il vit entre 15 et 20 ans.
Le Chamois est herbivore, il mange diverses herbes mais aussi des arbustes tels que le sorbier. Durant l’hiver, il se replie sur des herbes sèchent et aiguilles de conifères qu’il trouve en grattant la neige avec ses pattes.
Le principal « prédateur » du chamois, c’est l’hiver. Ensuite c’est l’homme car le chamois est un gibier apprécié, mais il y a aussi l’aigle qui s’attaque aux jeunes isolés, le renard qui ne pourchasse que les jeunes, le loup et le lynx quand ils sont présents.
Le massif des Ecrins abrite environ 15 000 chamois. En tout il y a environ 50 000 chamois dans les Alpes françaises.
Source: PNE
En Vallouise, il y a longtemps !
En 1855, le glacier Blanc et Noir se côtoyaient au bout du Pré de Madame Carle. Le récit de B. Tournier paru en 1901 nous fait découvrir cette région du bout du monde, effrayante, sauvage mais belle !
En Vallouise, il y a cinquante ans (par M. B. Tournier)
 Quel que soit le merveilleux et charmant pouvoir de la photographie, du dessin, et même de la peinture, il y a dans la nature des choses qu’ils ne peuvent représenter qu’imparfaitement, et qu’il faut avoir vues pour les connaître. Qui saura jamais ce que sont le désert, la mer, la forêt, la haute montagne, s’il ne s’est trouvé devant eux ? Il en est ainsi du glacier. Il manque quelque chose à ceux qui n’ont pas vu de près ce formidable entassement de neiges persistantes, ou déjà vitrifiées, ces masses mouvementées qui ressemblent tantôt à des cascades, tantôt à de grands fleuves surpris et figés dans leur course ; ce vaste dos qui promène sans effort les débris rocheux détachés des sommets voisins et s’en nettoie sans cesse, les ramenant en moraines serpentueuses sur ses bords ; ces petits lacs d’émeraude ; ces crevasses mystérieuses et effrayantes ; ces renflements hérissés de puissantes arêtes de glaces ; enfin, au bas, la voûte féerique qu’on dirait taillée dans le cristal, et d’où le torrent s’échappe bruyant et joyeux, comme chantant sa naissance et son bonheur de trouver la lumière.
Quel que soit le merveilleux et charmant pouvoir de la photographie, du dessin, et même de la peinture, il y a dans la nature des choses qu’ils ne peuvent représenter qu’imparfaitement, et qu’il faut avoir vues pour les connaître. Qui saura jamais ce que sont le désert, la mer, la forêt, la haute montagne, s’il ne s’est trouvé devant eux ? Il en est ainsi du glacier. Il manque quelque chose à ceux qui n’ont pas vu de près ce formidable entassement de neiges persistantes, ou déjà vitrifiées, ces masses mouvementées qui ressemblent tantôt à des cascades, tantôt à de grands fleuves surpris et figés dans leur course ; ce vaste dos qui promène sans effort les débris rocheux détachés des sommets voisins et s’en nettoie sans cesse, les ramenant en moraines serpentueuses sur ses bords ; ces petits lacs d’émeraude ; ces crevasses mystérieuses et effrayantes ; ces renflements hérissés de puissantes arêtes de glaces ; enfin, au bas, la voûte féerique qu’on dirait taillée dans le cristal, et d’où le torrent s’échappe bruyant et joyeux, comme chantant sa naissance et son bonheur de trouver la lumière.
Dans son ensemble, le glacier forme un tout. On dirait un grand être chargé de concentrer le froid et de représenter sa puissance. En haut, son vaste corps semble se souder à la roche et se confondre avec la neige pure des sommets, pendant que, la tête en bas, logée dans les flancs de la montagne, sa gueule vitreuse vomit sans cesse l’eau glacée.
Le glacier et assurément une des plus grandes curiosités alpestres, une merveille de glace, un chef d’œuvre du froid. Cependant, tout figé, immobile et mort qu’il paraisse, il est en réalité plein de vie. Jamais il ne se repose ; en dessus comme en dessous se fait une œuvre incessante ; il travaille et il est travaillé ; il se détruit et se renouvelle. Puis en vertu des lois admirables de transformation déposées par le Maître ouvrier dans la nature, alors qu’il semble ne pouvoir tirer de son sein que le froid et la stérilité, il devient une puissance bienfaisante, et ne rejette que des trésors de fraîcheur et de vie, qui vont apporter au loin la joie et la fécondité.
Quand on a vu les glaciers, on comprend l’irrésistible attrait qui pousse ceux qui reviennent les visiter ; et ceux aussi qui, épris pour eux de passion ou de curiosité, se sont établis pendant des mois sur leurs bords pour les observer et ravir les secrets de leur mystérieuse existence.
Les Alpes du Dauphiné sont dotées de glaciers magnifiques soit par l’étendue, soit par l’originalité. Le glacier Noir et le glacier Blanc, au fond de la Vallouise, sont de ce nombre. Malheureusement, il manque d’en bas d’un bon point de vue : le premier, tournant et remontant à gauche, va s’enfoncer dans les contours sinueux d’un cirque de roche absolument clos ; le second, suspendu à droite dans une haute vallée, ne présente aussi que son point d’arrivée et de déversement. On ne peut juger de la beauté et de l’étendue de ces glaciers, et généralement des glaciers de la région du Pelvoux, que par des ascensions, ou le passage des cols auxquels ils aboutissent : de là ils sont splendides.
A cette heure, avec le mouvement de recul auquel ils sont soumis, la partie basse de ces glaciers a beaucoup perdu de sa grandeur et de son charme. En se retirant et se séparant, ils ne laissent après eux qu’un dépôt informe et laid, un entassement de pierres et de boues qui s’allongent toujours, un pêle-mêle noirâtre, pour longtemps sans avenir pour la végétation qui seule pourrait l’adoucir. En Suisse, en Savoie et même en Dauphiné, les abords du glacier sont en général plus doux, soit que la retraite en soit moins prononcée, soit que la nature des dépôts soit plus favorable à la végétation. Pendant que la forêt, plus rapprochée, détache sur le blanc des neiges la verdure sombre de ses sapins, ou la silhouette frangée de ses mélèzes, les petites plantes s’avancent aussi de leur côté, et prospèrent dans un terrain qui atteste que depuis assez longtemps l’état des lieux n’a pas aussi sensiblement changé. A Zermatt, par exemple, le pâturage n’en est séparé que par quelques monticules où l’herbe a déjà pris pied ; quelques arbrisseaux s’y sont établis comme pour en voiler la nudité ; les saponnaires surtout les égaient de leurs grandes tiges à fleurs rosées ; la bergeronnette et le rossignol de muraille y font leur apparition ; le mouton, la chèvre, la vache même y trouve à brouter ; et la bergère, le bras en travers sur les yeux pour les abriter du soleil, peut trouver une distraction à son oisiveté en plongeant avec curiosité son œil rêveur dans la mystérieuse voûte de glace. – Ici, il n’y a que désolation et nudité.
Mon but n’est pas de décrire une fois de plus des régions qui l’ont été avec tant de charme et de vérité par MM. Tuckett, Whymper, Guillemin, Duhamel et bien d’autres. Je désire seulement fixer un tableau qui m’a ravi il y a une cinquantaine d’années, et conserver le souvenir des deux glaciers tels que j’eus le privilège de les voir quand ils se rencontraient encore au bout du Pré de Mme Carle.
 Leur masse était alors bien plus considérable. Le glacier Noir descendait lourdement et paresseusement de gauche comme une montagne éboulée, – noir, en effet, tout sali par les débris rocheux qui de tous côtés, dans le grand cirque, avaient roulés sur lui. A droite, juste à sa rencontre, arrivait le glacier Blanc, lui, en effet, bien blanc, propre, brillant, magnifique, tantôt uni, tantôt moutonné. Il ressemblait à un fleuve surpris et figé dans sa course et dans ses efforts. Puis, rencontrant un grand escalier de roc, il finissait par une chute de cent mètres. C’est là, surtout, qu’il était beau avec sa charge d’arêtes de glace aux formes bizarres, souvent immenses, pressées, penchées, qui les faisait ressembler à un peuple vaincu, malheureux, se lamentant, changé en glaçons, – immobiles comme la femme de Loth, et pourtant en marche, et à des degrés divers déjà penchées vers l’abîme. Enfin, au bas, rencontrant son vigoureux voisin noir qui lui disputait la place, il se repliait sur lui-même, se gonflait et se renforçait magnifiquement ; et, sous cet entassement même, s’ouvrait une splendide voûte qui semblait taillé dans du cristal, et finissait en arc surbaissés dans des crevasses mystérieuses. On y entendait tomber et murmurer l’eau ; il y avait d’indéfinissables reflets d’un bleu vert et une lumière de clair de lune.
Leur masse était alors bien plus considérable. Le glacier Noir descendait lourdement et paresseusement de gauche comme une montagne éboulée, – noir, en effet, tout sali par les débris rocheux qui de tous côtés, dans le grand cirque, avaient roulés sur lui. A droite, juste à sa rencontre, arrivait le glacier Blanc, lui, en effet, bien blanc, propre, brillant, magnifique, tantôt uni, tantôt moutonné. Il ressemblait à un fleuve surpris et figé dans sa course et dans ses efforts. Puis, rencontrant un grand escalier de roc, il finissait par une chute de cent mètres. C’est là, surtout, qu’il était beau avec sa charge d’arêtes de glace aux formes bizarres, souvent immenses, pressées, penchées, qui les faisait ressembler à un peuple vaincu, malheureux, se lamentant, changé en glaçons, – immobiles comme la femme de Loth, et pourtant en marche, et à des degrés divers déjà penchées vers l’abîme. Enfin, au bas, rencontrant son vigoureux voisin noir qui lui disputait la place, il se repliait sur lui-même, se gonflait et se renforçait magnifiquement ; et, sous cet entassement même, s’ouvrait une splendide voûte qui semblait taillé dans du cristal, et finissait en arc surbaissés dans des crevasses mystérieuses. On y entendait tomber et murmurer l’eau ; il y avait d’indéfinissables reflets d’un bleu vert et une lumière de clair de lune.
Quelle différence aujourd’hui ! Le glacier Noir s’est retiré, laissant après lui ses affreuses moraines toujours plus grandes, sales, branlantes, si pénibles à traverser ; quant au glacier Blanc, suspendu à cent mètres au dessus de son ancien lit, il a laissé à découvert la roche sur laquelle ses eaux se déversent sans gloire. Les observateurs disent que nos glaciers ont repris leur marche descendante, qu’ils sont en voie d’accroissement, et que la jeunesse actuelle peut espérer de les revoir tels qu’ils étaient dans leurs beaux jours. Si rien d’autre ne doit en souffrir, je ne puis que le lui souhaiter.
La curiosité ne nous eût pas manqué pour aller plus loin ; mais, alors, on n’osait pas même y penser. Rien n’était prévu, organisé, les voies même étaient ignorées ; le glacier était effrayant, et les parois de roches d’apparence infranchissables. C’était l’inconnu ! Il fallait être chasseur de chamois, fugitif, poussé par une nécessité quelconque, pour s’aventurer sur cette masse indéfinie et menaçante. Ces lieux allaient être dévoilés et rendus praticables par les Clubs Alpins ; mais ils étaient encore alors des bouts du monde.
Ce fond des vallées alpestres, spécialement ce fond de la Vallouise, est singulièrement impressionnant. De quelque côté que l’on porte ses regards, on ne voit que neige, glace, graviers, roches immenses, roussies, ravagées, partout closes sauf, en arrière vers l’étroit espace qui fut jadis le Pré de Mme Carle. Quelques touffes rampantes de sabine végètent à peu près seules du côté tourné vers le Sud ; plus loin, du côté du Pelvoux, protégés par sa base même, quelques vernes et mélèzes souffreteux et rabougris, dont plusieurs sont des vieillards de plusieurs siècles. C’est près d’eux que se montre aujourd’hui la masse rougeâtre et rassurante du précieux refuge Cézanne. Tout le reste est nu, déchiré, raclé, stérilisé, et parle de la guerre continue que se livrent ici les éléments.
Le soir surtout, ce coin perdu à quelque chose de sinistre. La masse écrasante du Pelvoux, ces blocs énormes précipités d’en haut, l’étroitesse de la vallée, la solitude absolue, tout y respire la crainte et le souci. C’est une sauvagerie et une solitude que rien n’adoucit ; l’on en est oppressé, et l’on pense avec soulagement à l’ouverture par laquelle on est venu et par laquelle on pourra s’en retourner. On comprend que la poésie antique, ignorante de bien des choses que nous connaissons, ait peuplé d’esprits, de demi-dieux malfaisants ou secourables, les mystérieuses et impressionnantes solitudes des eaux, des forêts, des montagnes. C’était particulièrement impressionnant alors : au sentiment de l’absolue solitude se joignait celui de l’inconnu ; point de refuge pour rassurer le visiteur, et en arrière une population alors assez mal famée.
Il se faisait tard. La sagesse conseillait de partir. Nous regagnâmes le Pré de Mme Carle. Quel pré ! En vain on en cherche l’herbe, et au moins les traces. Les glaciers l’ont enseveli ou dévoré. Il a bien pu être un pré ; pour le moment, ce n’est qu’une petite plaine de graviers à travers laquelle les eaux cherchent en serpentant leur chemin. A la vérité, les héritiers de cette dame n’en feront pas de longtemps gros argent ; mais il aura assez vécu pour valoir à son heureuse propriétaire, qui, elle, n’aura pas eu à risquer sa vie pour le conquérir, l’honneur d’avoir à jamais son nom gravé sur la carte de l’Etat-major, à côte de celui des plus célèbres ascensionnistes de toute nation.
Le soleil se couchait, et nous voulions voir encore. Ces lieux sauvages et désolés semblent posséder le privilège d’être à certains moments les plus beaux, et d’avoir leurs heures de triomphe. Ces déchirures, ces nudités, ces éboulis, ces horribles rochers, ces neiges, n’apportent alors au tableau que des éléments de beauté : les détails disparaissent, les duretés s’adoucissent, les laideurs se voilent ou se transforment ; il ne reste que des masses : et, sur ce fond puissant, comme sur une ébauche vigoureuse et magistrale , le pinceau du grand Artiste se promène et produit en un moment un tableau sublime de grandeur, d’harmonie et de coloris. Tout reçoit une parure vraiment céleste. En haut, dans une zone lumineuse, qui monte et s’éloigne peu à peu, les cimes allumées, dômes, pics, cornes d’or, neiges pures et rougies, se détachent sur un ciel d’outremer rosé, vous ravissent dans les régions du jour et de l’espérance. En bas, dans le fond, se répand un indéfinissable glacis à la fois transparent et intense, qui semble fait de toutes les couleurs, mais où foisonne l’indigo délayé dans l’or. Ce sont les voiles de la nuit qui montent comme poursuivant le jour.
Nus nous attardâmes si fort à ce Pré de Mme Carle, que nous ne pûmes qu’a grand’peine regagner les misérables chalets d’Ailefroide, où il fallait nous résigner à passer la nuit. Ils sont établis vers l’angle Nord du petit delta d’alluvions préservé entre le pied même du Pelvoux et la jonction des deux torrents, celui de Celse-Nière, qui vient du versant Sud du Pelvoux, et celui de Saint-Pierre que nous venons de suivre et qui, en cet endroit, s’est creusé un lit profond. Sur le petit pont branlant et presque à jour qui le traverse, la tête tourne et les genoux fléchissent lorsqu’on regarde cette eau s’enfuir vers un effrayant couloir où elle se débat avec fureur. Le sol est ébranlé, le bruit monte jusque vers la montagne qui le multiplie ; de nuit c’est inquiétant.
Nous allâmes au premier chalet, obstrué de fumier, de branchage, de chèvres, et de vaches guère plus grandes ; nous appelons ! Une femme échevelée se présente. Plus surprise encore que nous, elle ouvre de grands yeux, semble très inquiète de nous voir et très soucieuse surtout de ce que nous demandons à passer chez elle la nuit ; elle semble se demander ce que cela veut bien dire. Elle recule dans son antre noir, et revient suivi d’un homme de mauvaise mine, la tête très enfoncée dans le chapeau. Après quelques pourparlers avec notre guide, dans une langue qui leur était plus familière, ils consentent, comme dans un cas de force majeure, à nous laisser pénétrer dans leur intérieur, une tanière plus qu’un logis, si enfumé, si noir que, sans le feu, on n’aurait su de quel côté se trouvait la cheminée. La réputation, peu flatteuse alors, des habitants de la Vallouise, la mauvaise mine de nos hôtes, la solitude et l’éloignement de tout secours possible, l’inconnu, l’épouvantable bruit du torrent, qui faisait comme trembler le sol de ses secousses et semblait vouloir tout emporter, tout se réunissait à ce moment pour calmer en nous la poésie de la montagne et nous ramener à la réalité. Je ne pouvais m’empêcher, au fond, d’approuver quelque peu la voix féminine qui me disait : « Il eût fallu me croire et ne pas trop s’attarder là haut en dessins et en admiration ».
 On nous parqua sur un peu de paille dans un petit compartiment attenant à la cuisine, au dessus du bétail dont nous entendions tous les mouvements. Nous ne dormîmes pas comme nous aurions voulu. Beaucoup d’insectes – et le torrent semblait redoubler son vacarme comme pour l’imposer à la nuit et régner à son tour sur le silence de la nature. Nous n’avions jamais rien entendu de pareil ; on eût pu se croire au soir d’un nouveau déluge. Nous sourîmes à la lumière du jour. Lassitude, insectes, mauvais logis, tout est vite passé dans l’oubli ; mais nous n’avons jamais oublié la belle soirée passée au Pré de Mme Carle.
On nous parqua sur un peu de paille dans un petit compartiment attenant à la cuisine, au dessus du bétail dont nous entendions tous les mouvements. Nous ne dormîmes pas comme nous aurions voulu. Beaucoup d’insectes – et le torrent semblait redoubler son vacarme comme pour l’imposer à la nuit et régner à son tour sur le silence de la nature. Nous n’avions jamais rien entendu de pareil ; on eût pu se croire au soir d’un nouveau déluge. Nous sourîmes à la lumière du jour. Lassitude, insectes, mauvais logis, tout est vite passé dans l’oubli ; mais nous n’avons jamais oublié la belle soirée passée au Pré de Mme Carle.
Nous restâmes une bonne partie de la matinée à Ailefroide, à flâner, à nous saturer d’air pur, de senteurs alpestres, d’impressions forestières et prairiales, de la vie des gens pauvres, fraternisant avec poules, ânes, vaches, chiens, rossignols de muraille, qui ont toujours aimé les pauvres masures ; enfants surtout, qui firent cercle, me regardant curieusement me couvrir de savon pour m’embellir un peu au rasoir devant un petit miroir piqué au montant de la porte. Nous visitons jardins et chalets, et remarquons d’ingénieuses petites constructions en contrebas dont le toit est presque au niveau du sol, où l’on descend par un escalier extérieur, et dans lesquelles on abrite des provisions de pommes de terre qui ont cru ici et qu’on y retrouve au printemps.
Repassant le pont tremblant et délabré de la veille, où l’eau fait si grand vacarme, nous redescendons par la rive gauche, par un sentier moins doux, mais plus ajouré, bordé de trembles et de bouleaux à l’écorce blanchâtre, sur lesquels, à chaque nœud, sont dessinés comme de grands yeux qui semblent curieux de nous voir passer. Nous nous retournons bien souvent pour envoyer nos adieux et nos regrets au grand Pelvoux, dont le soleil dore en haut les larges épaules. Nous traversons les jolis hameaux des Claux, de la Pisse, de Saint-Antoine, à demi cachés sous les noyers. La population est toute aux champs : au village, rien que des malades ou des enfants. C’est la fin d’août : le temps est plus court qu’ailleurs dans ces vallées, où la mauvaise saison finit tard et commence tôt. L’on sème et l’on moissonne souvent tout à la fois ; bien des gerbes sont déjà étalées au soleil sur les galeries : ici on arrache le chaume fortement odorant ; là on divise et l’on disperse, tout bonnement avec la main, de tout les instruments le plus perfectionné, le fumier que d’autres enterrent avec de misérables attelages, quelquefois formés d’une vache et d’un âne, avec une charrue primitive qui a des rapports si frappants avec celle des Arabes qu’on la dirait héritée des Maures ou Sarrasins qui ont si longtemps occupé les passages des Alpes, et y ont tant laissé de leurs noms et de leurs souvenirs ; nous eûmes même l’occasion de voir des attelages où des femmes tirées à côté d’un âne. Ce n’est donc point une invention ! Mais la légèreté du sol et le peu de profondeur du sillon portent à croire que cette peu digne obligation, imposée quelquefois dans ces parages à la reine de la création, est moins rude que ce qu’on pourrait croire.
On trouve rarement un beau type par ici. Sur le seuil d’une porte arrondie, que les pampres d’une treille ornaient de leurs gracieux festons, nous eûmes pourtant une apparition charmante, digne du pinceau d’un maître. Une jolie paysanne un peu plus bourgeoise, à la figure douce, cœur et croix d’or au cou, amuse un enfant qui rit aux éclats. Pour entretenir sa gaieté, et selon l’usage de toutes les mères, elle lui tient un langage impossible, pousse d’absurde petits cris, et lui débite toute sorte de niaiserie qu’il ne manque pas de prendre pour du bon argent, ou de bonnes raisons, ce qui accroît la satisfaction de la maman, qui, dans la joie de produire son beau poupon, oublie que nous l’admirons bien autant elle-même. Que Dieu les bénisse et les conserve tous les deux !
L’idée nous prit de gravir les pentes d’en face, à la recherche d’un point d’où l’on pût un peu mieux voir le Pelvoux, toujours plus ou moins caché, rogné du moins par quelque repli de montagne, et qui, malheureusement, en Vallouise surtout, manque d’une vue d’ensemble. Il ne se présente tout à fait bien, au complet et dans toute sa beauté, que de loin, ou de haut par quelque forte ascension. Nous grimpâmes assez longtemps par champs et prés sans réussir à notre satisfaction ; mais ce fut encore une bonne journée de saine flânerie, comme il est utile et permis d’en prendre quelque fois. Ensuite, sur une indication du guide, nous allâmes frapper à la porte d’une ancienne maison à l’air quelque peu bourgeois, chez les Morand, braves gens qui voulurent bien nous recevoir et mettre à notre disposition une grande chambre où bien des choses semblaient parler de grandeurs passées. En causant, nous apprîmes que c’est de ce logis que sont sortis les Morand qui se distinguèrent à Lyon, comme les Tholozan de Vars, au point d’y établir leurs noms sur quais, places ou ponts. « Nous sommes pauvres, me dit le patron du lieu : dans ce pays on a bien de la peine à se maintenir. Ont y vit, mais on ne peut pas pousser les enfants, ni même entretenir les maisons. Autrefois, c’était plus facile, et il est sorti de chez nous des savants ; il y a même eu des évêques dans la famille ! ».
Le matin ,nous remarquâmes que nos draps de lit étaient traversés par de forts belles guipures. « Je crois, me dit ma compagne, qu’on nous a fait coucher dans des nappes d’autel, qui seront venus de chez Monseigneur ! ».
Nous prenons très amicalement congé de nos hôtes, et du Pelvoux dont la tête est bien en face. Il va disparaître ; et j’aime à noter que c’est le capitaine Durand, de l’Etat-major, un Aveyronnais, mon compatriote, qui, en 1835, en fit la première ascension, avec sept à huit hommes, pour la triangulation. Il y éleva une pyramide de treize à quatorze pieds autour d’un mélèze qui en avait quinze. C’est la tradition du pays.
C’est par Entraygues et les cols de la Cavale et de Champoléon, en remontant la Ronde, que nous voulions rentrer en Champsaur. Un ami, alors sous-inspecteur des forêts à Embrun, connaissant nos projets et sachant le sentier difficile du côté de Champoléon, avait bien voulu nous promettre d’envoyer au devant de nous, au col, un des ses gardes ; il ne fallait pas manquer à un rendez-vous donné en pareil endroit.
Nous quittâmes Vallouise dès l’après-midi pour aller coucher à la cabane des bergers de Bonvoisin, malgré le temps devenu très lourd et des nuages menaçants. Nous nous enfonçâmes dans la gorge d’Entraygues, par moments si resserrée qu’il n’y a place que pour le sentier et le torrent. Le ciel s’assombrissait, les gros nuages, s’entr’ouvrant, laissaient par moments passer des rayons de lumière qui faisait reluire en avant le glacier si bien nommé la Peyre de Veyre (Pierre de verre ou Verrière de pierre) ; puis des éclairs et des coups de tonnerre de mauvais augure. Bientôt, tout en retentit. C’était magnifique et bien inquiétant ! Nous étions déjà hors de la gorge ; mais il restait une forte montée pour atteindre la cabane. En aurions-nous le temps ?
Il fallait franchir un assez gros torrent trouble et gonflé, et c’était impossible par les pierres. « Je vais vous passer, dit le guide ; j’ai bon dos et je connais la passe. – Eh bien ! passez d’abord le loulou, moi après, et Madame à la fin. » – Très haut rebroussé, et tâtant le sol avec son bâton, il nous tira à son honneur et à notre satisfaction de ce mauvais pas. Mais nous tombions dans un autre, car la pluie se mit à nous envoyer son avant-garde de grosses goutes qui disaient tout. Nous étions jeunes, et pouvions mieux supporter l’essoufflement auquel nous nous obligeâmes. Nous atteignîmes la cabane comme le plus dru s’en mêlait. Nous n’y arrivions pas seuls. De tous côtés accouraient vaches et veaux, chevaux, ânes, tous les pensionnaires de cette belle montagne. C’était comme aux jours de Noé autour de cette arche de salut. Tous eussent bien voulu pénétrer dans ce refuge de quelques mètres ; malheureusement pour eux, on n’y pouvait recevoir que les gens, et il était pénible d’avoir à leur refuser une hospitalité qu’ils venaient successivement demander avec une insistance digne d’un meilleur succès.
L’hôtesse, une brave femme, assez ébouriffée, nous reçut en levant les bras au ciel : « Eh ! pauvre monde, que venez-vous querre ici ? » Les bergers arrivent aussi, couvert de sacs. Après qu’ils eurent reconnu le troupeau, quelques bêtes absentes les inquiétaient. « Avec ce temps, disaient ils, elles peuvent se précipiter ! »
Nous nous séchâmes devant un bon feu de rhododendron et de sabine, et soupâmes principalement d’excellent lait dans lequel fut directement jeté le café. Deux choses troublaient notre satisfaction de nous trouver dans un si précieux abri : c’étaient l’agitation, l’angoisse, les gémissement des pauvres animaux qui se pressaient et faisaient mur devant la cabane, sentant que là était le bonheur : leurs plaintes faisaient pitié ; puis l’intense fumée qui régnait à l’intérieur, à partir de 60 à 80 centimètres du sol, et nous obligeait à nous tenir à demi couchés.
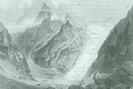 Au dehors, éclairs, tonnerre, averses continuèrent jusque bien avant dans la nuit, que nous passâmes à peu près blanche , et non sans causer beaucoup, car, lorsqu’on sait les faire parler, les pâtres ont plus à dire qu’on ne croit. En tous cas, ils en savent plus que nous sur la région appelée la montagne. Ils nous parlent troupeaux, chamois, herboristes, accidents. Tout près venait de se passer une scène dramatique. Un homme de Vallouise avait commis dans sa propre famille, dit la femme, « un crime que ça ne peut pas se raconter. Mais ça se sut, et il vint se cacher ici, à côté, dans une balme. On le savait, mais il était fort et armé ; comment l’avoir ? Les gendarmes sont fins. Ils se coupèrent la moustache et s’habillèrent en homme du pays. Le brigadier se mit sur la tête un drap comme on en prend à la montagne pour les foins ; il put comme cela monter et s’avancer tout près. L’autre le vit, mais ne se méfia pas et ne le reconnut que quand il fut trop près et lui eut sauté dessus en l’empêchant de prendre le fusil. Ils se roulèrent, mais il le tint jusqu’à ce que le camarade resté en arrière fut arrivé. Ah ! qu’ils l’eurent bien ! Monsieur, ces gendarmes, il faut s’en méfier. Ils les savent toutes ! et ils sont si contents d’attraper quelqu’un ! – Oui, lui dis-je, mais s’ils font la peur des méchants, ils sont les amis et protecteurs des gens de bien ? – ça, c’est vrai ! N’y a qu’à bien faire pour ne craindre ni gendarme, ni personne. »
Au dehors, éclairs, tonnerre, averses continuèrent jusque bien avant dans la nuit, que nous passâmes à peu près blanche , et non sans causer beaucoup, car, lorsqu’on sait les faire parler, les pâtres ont plus à dire qu’on ne croit. En tous cas, ils en savent plus que nous sur la région appelée la montagne. Ils nous parlent troupeaux, chamois, herboristes, accidents. Tout près venait de se passer une scène dramatique. Un homme de Vallouise avait commis dans sa propre famille, dit la femme, « un crime que ça ne peut pas se raconter. Mais ça se sut, et il vint se cacher ici, à côté, dans une balme. On le savait, mais il était fort et armé ; comment l’avoir ? Les gendarmes sont fins. Ils se coupèrent la moustache et s’habillèrent en homme du pays. Le brigadier se mit sur la tête un drap comme on en prend à la montagne pour les foins ; il put comme cela monter et s’avancer tout près. L’autre le vit, mais ne se méfia pas et ne le reconnut que quand il fut trop près et lui eut sauté dessus en l’empêchant de prendre le fusil. Ils se roulèrent, mais il le tint jusqu’à ce que le camarade resté en arrière fut arrivé. Ah ! qu’ils l’eurent bien ! Monsieur, ces gendarmes, il faut s’en méfier. Ils les savent toutes ! et ils sont si contents d’attraper quelqu’un ! – Oui, lui dis-je, mais s’ils font la peur des méchants, ils sont les amis et protecteurs des gens de bien ? – ça, c’est vrai ! N’y a qu’à bien faire pour ne craindre ni gendarme, ni personne. »
Succombant au sommeil et à la fumée, nous laissâmes notre ami et compagnon M. Broux, instituteur, particulièrement amateur de géographie, en discussion avec l’un des pâtres sur la situation du Mont Ararat, que celui-ci soutenait devoir être là, pas bien loin, en Savoie, « puisqu’il y a aussi, pour sûr, disait-il, le Mont Thabor ». Je crains bien qu’avec toute sa géographie l’ami Broux ne soit pas parvenu à le dissuader d’une semblable erreur.
Dès l’aube nous sortîmes fatigués encore, mais bien reconnaissants. Tout était changé : l’air était froid, mais le pâturage rafraichi par ce grand lavage, et le ciel d’une parfaite limpidité ; vis-à-vis, au Nord, le cirque de hautes roches où se concentrent d’immenses glaciers était admirable. Quel dommage de ne faire que passer devant ces magnificences ! Regardons bien du moins, et tâchons d’en emporter l’image durable dans les yeux et dans l’âme.
Le pâtre, depuis longtemps sorti, rentra content d’avoir retrouvé ces génisses, qui, faisant preuve d’une sagesse précoce, s’étaient abritées sous une avance de rocher. Comme il ne peut que bien connaître la montagne, nous le prenons pour nous guider. Il arrive avec son fusil. « Il y a souvent des chamois là-haut, dit-il. –Eh bien ! l’ami, s’il y a des chamois là-haut, je tiens beaucoup à les voir, et non à les effrayer. Aujourd’hui vous êtes à moi, un autre jour vous pourrez y aller pour vous ! » Bien nous en prit, car, après une assez longue ascension, en débouchant sur une croupe, cet homme aux yeux de lynx : « Les voilà ! dit-il, tenez, là, à gauche ; ils vont traverser sur la neige ». Nous étions en face d’un assez grand névé, étendu comme un drap blanc sur l’éboulis qui descendait de la pente même du col que nous allions gravir. Et nous voyons avancer sur cette neige, à portée de fusil, fier, élégant, tête haute, un de ces magnifiques animaux, puis, l’un après l’autre, sans se presser, deux, trois, et jusqu’à quinze. Qu’ils sont beaux, ainsi libres, chez eux, s’harmonisant avec la nature pour laquelle ils ont été faits ! Le névé franchi lentement, les voilà sautant et filant promptement à droite. Mais ce n’est pas fini ! En voici encore un qui s’avance sur la neige. Il se retourne. est-il blessé ? Non, c’est une mère en sollicitude pour un petit qui fait des difficultés pour la suivre. Il vient pourtant ; puis il hésite encore, et la bonne mère l’attend tous les quelques pas. Vers le milieu elle se couche : le petit vient. Alors elle se lève et passe à l’autre bord ; cette fois le petit court après elle, et ils disparaissent bientôt eux aussi dans les rochers.
En haut, sur le col même, quelqu’un debout. C’est sans doute le garde qui nous attend déjà ? Mais, non, c’est encore un chamois qui, les autres passés, s’empresse de les suivre. Ce spectacle ne valait-il pas cent fois le rôti de chamois que nous eût servi quelque hôtesse ?
Le col de la Cavale est pelé, mais doux. Il est double. De Vallouise il aboutit d’abord au sommet de l’Argentière, val étroit, très nu, surtout en haut, mais à belles lignes. Un peu plus bas on aperçoit un petit lac très engageant, un vrai miroir à chamois. C’est un peu plus haut, à droite du col de la Cavale, que se présente celui de Champoléon, où nous vîmes bientôt arriver notre garde avec une ponctualité toute militaire. Ce brave homme nous fut très utile, car des nuages vinrent nous y chercher ; et, sans lui, je ne sais trop comment nous nous serions tirés du sentier glissant, à peine tracé dans les schistes, par lequel débute la descente sur Champoléon.
Je ne m’arrête pas à cette vallée. C’est toujours l’Alpe grandiose et intéressante ; mais de ce côté c’est très long, et rien de particulièrement beau. Il vaut mieux se hâter et regagner le beau et riche Champsaur.
Source : Annuaire du CAF -28ième année – 1901
Le Peyrou et la Meije
 Dans la montagne dominant Villar d’Arène, il y avait autrefois un puissant château très haut perché. Le maître du château était paillard, grossier, rude, mais il n’y avait pas de chasseur plus audacieux que lui : infatigable, il savait forcer une harde de chamois ; courageux, il savait attaquer dans sa tanière, le terrible ours des montagnes ; hardi, il savait franchir les rochers les plus abrupts.
Dans la montagne dominant Villar d’Arène, il y avait autrefois un puissant château très haut perché. Le maître du château était paillard, grossier, rude, mais il n’y avait pas de chasseur plus audacieux que lui : infatigable, il savait forcer une harde de chamois ; courageux, il savait attaquer dans sa tanière, le terrible ours des montagnes ; hardi, il savait franchir les rochers les plus abrupts.
Ses propriétés s’étendaient du Chambon jusqu’à Briançon. Il était devenu le maître de la route du Lautaret où il avait installé un péage. Un jour qu’il visitait ses terres, il rencontra une jeune fille qui filait de la laine devant sa maison. Anne, car elle portait ce doux nom, était plus blonde que la moisson, plus belle que les Vénitiennes et plus sainte que la Mère de l’Enfant de Dieu. Il en tomba follement amoureux et devant son refus, il essaya de rompre sa chair et d’égarer son esprit dans des entreprises de chasse périlleuses, qui ne lui donna ni le calme ni le repos. Il essaya de se gorger d’autres chairs et cela ne fit pas davantage.
Enhardi par le Démon qui s’était emparé de son cœur et de son esprit, il chargea ses serviteurs de s’emparer de la jeune fille qui la ramenèrent par une nuit sans lune au château. Elle ne lui fit pas de reproches, mais elle lui fit serment qu’il n’aurait rien de sa chair. Il essaya de s’approcher d’elle, et un soir, comprenant que le démon guidait ses gestes, Anne se servit pour se défendre de la seule arme en sa possession: le fuseau. Elle le blessa à la main droite et la laine blanche devint rouge. Sentant sa vie éternelle en péril, la jeune fille en profita pour s’enfuir.
Au château, la colère s’empara du seigneur chevalier, dans la nuit, un hurlement sinistre retentit du Lautaret à Briançon, les âmes pieuses se signèrent pressentant un malheur, les pénitents revêtirent leur cagoule et prièrent le reste de la nuit.
Après bien des fatigues, Anne arriva au sommet du plateau en face duquel se dresse la Grande Meije.
On avait édifié à cet endroit un oratoire en l’honneur de la Mère de Dieu. Lasse, le corps rompu, la jolie fileuse s’agenouilla devant l’autel et se mit à prier. Pendant ce temps, sans doute guidé par le diable, le seigneur chevalier la trouvât et lorsqu’il ouvrit la porte de l’oratoire. Elle s’écria: «Sainte Vierge, je suis seule, prenez-moi, protégez-moi, cachez-moi dans le rocher, au sommet de la Grande Meije, par pitié !» Et le miracle se produisit, une lumière céleste éblouit le seigneur chevalier qui entendit les paroles divines: «Repens-toi, chevalier félon, car cette jeune fille si pure sauve son âme. Pour expier tes fautes tu ne seras plus le lion courageux et libre du val de la Romanche, mais le lion de pierre en face de moi, sur le Peyrou d’Amont, en face d’elle qui a choisi le sommet de la Grande Meije». Pendant toute l’éternité, ils seront ainsi en face l’un de l’autre: le chevalier déloyal et la belle fileuse.
Dans ce face à face éternel, on dit que la Meije devient parfois plus aérienne lorsque la belle fileuse pardonne à son persécuteur. En revanche quand elle se voile de nuages menaçants, les gens disent qu’elle se protège ainsi des attaques du seigneur chevalier tapit en bas au Peyrou d’Amont qui a pris définitivement la forme d’un lion couché et blessé à mort.
Que ceux qui feront la Meije et bivouaqueront au sommet se recueillent et écoutent. En se penchant vers l’abîme, par-dessus le glacier, ils entendront les plaintes angoissantes du seigneur chevalier, mais tout près d’eux, ils sentiront la présence de leur ange gardien qui veillera sur eux. Anne prie pour ceux qui exposent leur vie par noble idéal, invisible mais présente, elle les suit de rocher en rocher, elle les réconforte. Si le grand malheur survient, alors, elle leur apparaît et adoucit les transes de la mort. Elle se penche sur le pauvre corps brisé et dans un grand élan d’amour elle lui donne la grande joie de mourir dans ses bras.
Source : Association coutumes et traditions de l’Oisans